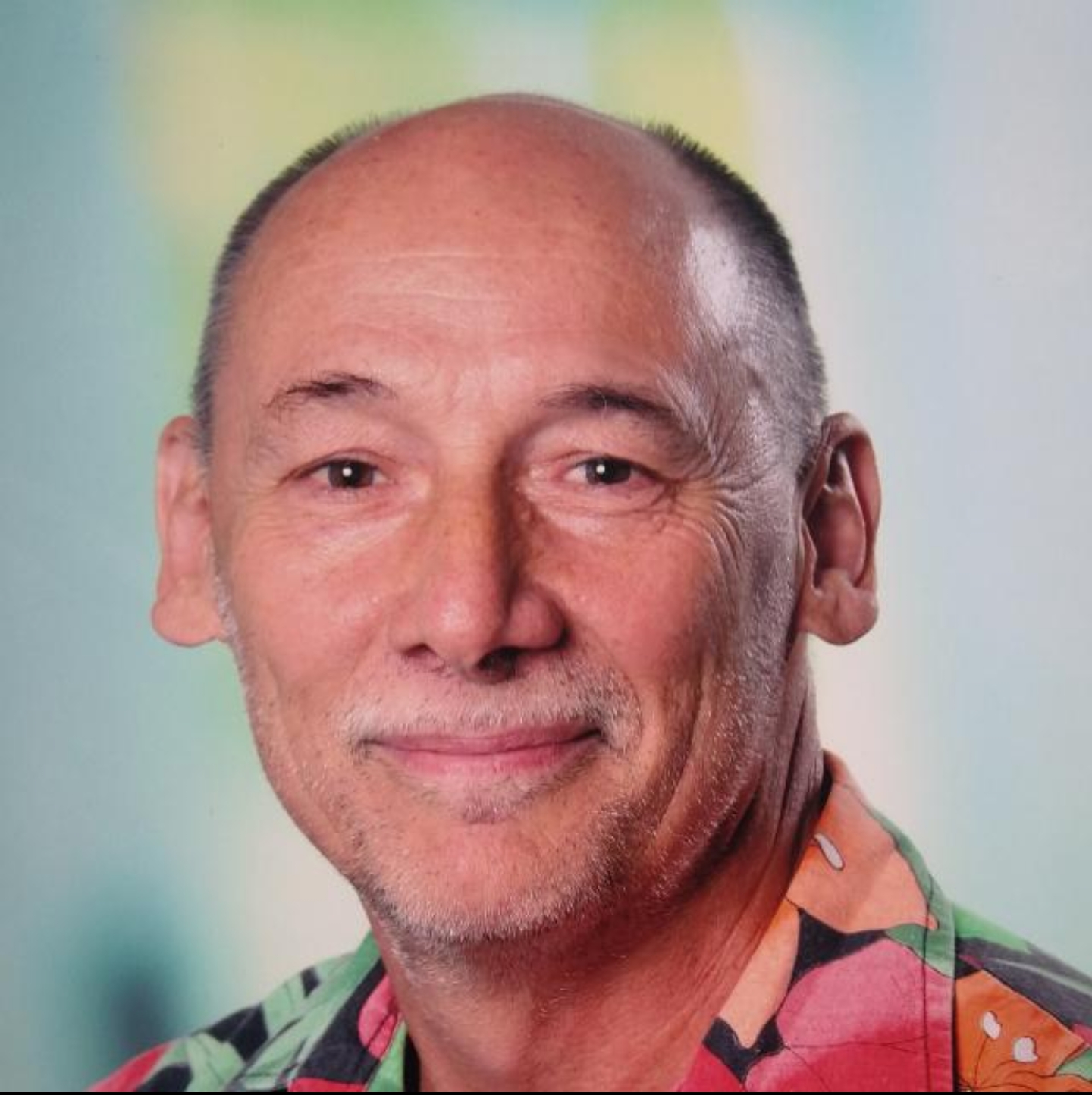Balade sur la roche de Solutré semaine 14 (du 31 avril au 6 mars).
A vous de titrer ces photos classées par ordre alphabétique (noms latins).
Réponses et compléments en dessous de la galerie.





















1 : Alliaria petiolata, Alliaire officinale ou Herbe à ail, Brassicacée.
Les membres de cette famille sont souvent cultivés par l’homme car se démarquent par leurs saveurs remarquables et recherchées (choux, navet, moutarde, raifort, roquette, cresson, roquette…).
Les feuilles, à odeur d’ail lorsqu’elles sont froissées, sont cordiformes, dentées au sommet, reniformes et crénelées à la base. La seconde année, elle produit de petites fleurs blanches à quatre pétales qui se tranforment en fruits (siliques). Un bourgeonnement sous-terrain lui permet de coloniser son mileu proche, au point de devenir parfois une invasive redoutée.
Ses racines possèdent un goût proche du radis et sont consommables. Les jeunes feuilles mélangées dans une salade apportent un léger goût d’ail. Les tiges cueillies au printemps ont un goût sucré de chou.
On peut également utiliser ses feuilles pour faire du beurre* ou du pistou. Les fleurs ont aussi un goût d’ail et peuvent servir à parfumer tous types de plats.
Ses graines, une fois écrasées, peuvent remplacer les graines de moutarde.
*Mixer 100 grammes de feuilles crues (sans le pétiole) avec 200 grammes de beurre. Rajouter huile d’olive, jus de citron et sel à votre convenance…
2 : Bryonnia dioïca, Brionne dioïque ou navet du diable, Cucurbitacée
Les cucurbitacées sont toutes plus ou moins rampantes ou grimpantes (courges, courgettes, cornichons, pastèques…).
Feuilles vert clair à cinq lobes comme celles des feuilles palmées de lierre. Heureusement qu’elles dégagent une odeur nauséabonde qui n’engage pas la cueillette car toutes les parties de la plante sont plus ou moins toxiques, mais surtout la racine et les fruits. Photos Francini-mycologie.
Sauvages du Poitou : Elle peut mesurer en fin de saison 4 à 6 mètres de long! Elle est vivace par sa racine.
Ses vrilles spiralées en tire-bouchon se déroulent en s’allongeant comme des fouets, décrivant lentement de grandes rotations, à la recherche d’un support à agripper. N.B. : Associée à la magie blanche.
Rappel : au xiie siècle, Hildegarde de Bingen indique : « Pour se garantir de l’ivresse, boire du jus de bryone avec autant de vinaigre, ainsi toute la semaine on ne sera point ivre ».
Plante dioïque : les fleurs mâles sont portées par des rameaux plus long que les feuilles à l’aisselle desquelles ils s’insèrent, tandis que les fleurs femelles sont portées par des rameaux plus courts.
Les fleurs ont une corolle soudée à 5 lobes, blanc jaunâtre (verdâtre), veinés. Les fleurs mâles ont un calice en forme de cloche à 5 dents, et 5 étamines dont 4 soudées 2 à 2 par leur filet et une libre.
Les fleurs femelles ont 3 styles soudés à la base, et terminés par 3 stigmates globuleux et poilus.
3 : Carex halleriana, Laîche de Haller, Cyperacée.
Forme une souche gazonnante dense. Feuilles étroites (2-3 mm), rudes, épi mâle terminal solitaire, roux et blanc, épis femelles globuleux, pauciflores, collés à l’épi mâle et subsessiles. Orchid-nord.

4 : Draba muralis, Drave des murs, Brassicacée, (ex Crucifère) se reconnaît à ses feuilles caulinaires sessiles, dentées, embrassant la tige par des oreillettes arrondies. Rosette à la base. Taille : 8-45cm.
5 : Fraxinus exelsior, Frêne commun ou Frêne élevé, Oléacée.
Ce nom provient du latin fraxinus qui veut dire « foudre », car lorsqu’il est isolé, il attire la foudre.
Grand arbre pouvant vivre de 150 à 200 ans, et pouvant atteindre de 20 à 45 mètres de haut selon le milieu. Les pieds sont soit mâles, soit femelles soit hermaphrodites. Ses bourgeons noirs sont discriminants. Ecorce vert-grisâtre qui se fissure au-delà de 30-40 ans.
Feuilles opposées pennées à 5-15 folioles lancéolées.
Les fruits sont des samares aplaties à aile allongée persistant tout l’hiver.

Son bois était autrefois utilisé pour la fabrication des manches d’outils, aussi est-il très fréquent à proximité des villages. Son feuillage était également utilisé pour nourrir les animaux d’élevage.
il est également un excellent bois de chauffage. Très dense, il doit, comme le hêtre et le chêne, sécher longtemps pour atteindre le taux d’humidité souhaité, c’est-à-dire au maximum 20%.
Dans certaines régions, on fabriquait autrefois avec ses feuilles une boisson ménagère désaltérante, légèrement pétillante et alcoolisée (2-5%), appelée « frênnette » ou « cidre de frêne ».
Victime de la chalarose.
Comparaison FloreAlpes avec Fraxinus ornus.
6 : Fraxinus ornus, Frêne à fleurs, Oléacée.
Il possède des feuilles composées de 20 à 30 cm de long avec 5 à 9 folioles de 5 à 10 cm de long et 2 à 4 cm de large, à bord finement dentelé et ondulé.
Il est beaucoup moins fréquent que Fraxinus exelsior, mais il semblerait que sa fréquence est en train d’augmenter ces dernières années. Son écorce grisâtre et lisse le distingue de son « cousin » méditerranéen, le Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia).
Il est souvent cultivé comme arbre d’ornement en Europe pour ses inflorescences décoratives.

7 : Genista pilosa, Genêt poilu, Fabacée.
Sous-arbrisseau buissonnant de 20 à 50 cm, prostré ou érigé. Fleursauvageyonne.
Ses tiges sont couchées à la base, ses feuilles sont pubescentes en dessous, comme le dos de ses fleurs qui dégagent un agréable parfum ainsi que ses fruits (gousses). Sa floraison ne fait que commencer.
FloreAlpes : Ses fleurs sont d’un jaune éclatant et dégagent un agréable parfum.
8 : Helleborus foetidus (fleur), Hellébore fétide. Renonculacée toxique.
Le genre comprend une quinzaine d’espèces de vivaces à vie courte dont les fleurs mellifères sont précieuses en hiver, quand la nourriture manque pour les rares insectes pollinisateurs.
C’est une calcicole qui aime les sols secs et se complait sur les pentes ensoleilées de la Roche de Solutré.
Fétide, car ses feuilles, quand on les froisse, sont très malodorantes…
D’une touffe de feuilles coriaces vert foncé, pétiolées et palmées de 7 à 9 folioles, émerge à partir de janvier une robuste tige portant de drôles de cloches vertes bordées de pourpre penchées (protection contre les intempéries) à 5 sépales jaune-verdâtre à bords rougeâtres; follicules à bec crochu ; odeur désagréable. Elles sont composées de 5 sépales pétaloïdes persistants et de 5 pétales transformés en cornet sécrétant du nectar, ainsi qu’une levure qui, en fermentant, assure un chauffage d’appoint.
N.B. : Fleurit ordinairement deux fois, la première fois vers cinq ans (entre quatre et neuf ans, parfois déjà la seconde année). De nouvelles tiges naissant de la souche assurent une seconde floraison l’année suivante, cette seconde floraison étant généralement suivie de la mort de la plante. Lien.
9 : Helleborus foetidus, (fruit), Hellébore fétide. Renonculacée toxique.
Du sémitique hélibar qui signifie remède contre la folie : dans la fable de La Fontaine, le lièvre conseille à la tortue : «ma commère, il vous faut purger avec quatre grains d’ellébore», car il la croit folle.
L’hellébore ou « herbe aux fous » dans l’histoire moderne et contemporaine.
Il est composé de 1 à 5 follicules coriaces renflés à maturation, ridés transversalement et surmontés d’un bec. Les graines, qui possèdent un élaïosome , sont semées par les fourmis (myrmécochorie). On retrouve ainsi les rejetons souvent à plusieurs mètres des plantes mères.
Comparaison FloreAlpes avec l’Hellebore vert + Hellébores du jardin de Malorie.
10 : Myosotis ramosissima, Myosotis hérissé, Boraginacée.
Myosotis vient des termes grecs myos et ous et signifie littéralement «oreille de souris»; une référence à la forme et au duvet de ses feuilles.
Pour le différencier de M. arvensis, pensez à la théorie de l’allocation des resources : ramosissima étant très poilu, ses pédocules floraux sont courts (ramosissima est radin sur ses pédocules floraux).
Les ressources sont limitées, chaque espèce les distribue différemment vers ses organes.
La façon d’allouer les ressources a évolué par sélection naturelle, elle est donc héritée génétiquement.
Pour aller plus loin.

Comparaison FloreAlpes avec M. arvensis + Autres Myosotis par sauvages du Poitou.
Prochainement dans mon référentiel : Myosotis de notre région
11 : Lactuca virosa, Laitue vireuse. Astéracée. (feuille de la rosette seulement).
Au printemps, elle présente une rosette d’une vingtaine de feuilles vert tendre à taches violettes.
Elle produira une tige dépassant parfois 2m, raide, robuste, épineuse, violacée portant de nombreuses ramifications à fleurs jaunes. C’est une des plantes les plus illustres qui soient connues depuis l’Antiquité. Son latex très amer fournit une fois séché une matière brun foncé très amère, le « lactucarium », utilisé au xixe siècle par les médecins pour remplacer l’opium dans les cures de désintoxications consécutives à l’usage de cette drogue. Peut être confondue avec L. seriola, mais ses feuiles sont non déviées obliquement et à nervure dorsale garnie d’aiguillons raides.
12 : Noccaea montana, (Thlaspi montanum), Tabouret des montagnes, Brassicaceae.
Dédiée à Domenico Nocca (1758-1841). Forme des rejets rampants.
Feuilles entières, les basilaires en rosette basale, longuement pétiolées, obovales, les caulinaires oblongues à oreillettes obtuses. Tige dressée 10 à 20 cm.
Inflorescence : fleurs (à 4 pétales blancs) en grappe s’allongeant en cours de floraison.
Fruit : silicules cordiformes échancrées en cuiller à long manche s’écartant de la tige.
Plusieurs pieds sont issus d’une même racine qui forme des rejets rampants.
13 : Microthlaspi perfoliatum, ex Noccaea perfoliata, Tabouret perfolié, Brassicacée.
Les feuilles caulinaires, glauques, sont en forme de cœur allongé engainant la tige.
Fleurs blanches, très petites. Fruits sont aussi en forme de cœur. Racine grêle, pivotante.
Autre tabouret : Tabouret à feuilles rondes, Noccaea rotundifolia par FloreAlpes.
14 et 15 : Ophrys virescens, Ophrys litigiosa, Ophrys petite araignée ou Ophrys litigieux. Orchidée.
(Ophrys sphegodes subsp. araneola, Ophrys araneola). Photo Laurent Francini.Lien.
Observé depuis fin mars dans les pelouses exposées au sud des roches de Vergisson et de Solutré.
Caractérisé par des feuilles vert-bleu à aspect réticulé en rosette basale, par une inflorescence de 4 à 10 petites fleurs aux sépales à bord très sinueux, de couleur vert blanchâtre, aux pétales un peu plus jaune et au labelle brun rougeâtre, à pilosité marginale claire et à bordure généralement jaune.
Le labelle présente une macule centrale à reflets gris bleu généralement en forme de H.
C’est une plante de pleine lumière à mi-ombre sur substrat calcaire.
Souvent confondu avec O. aranifera; il s’en différencie notamment par sa petite taille.
N.B. : Le labelle bombé, de la taille d’un grain de café et de la couleur d’une châtaigne, s’éclaircit en quelques jours : la marge jaune semble s’étendre vers le centre du labelle qui vire vers un jaunâtre délavé.
Les fleurs du bas (anciennes) sont donc beaucoup plus claires. Photo : fleur de quelques jours.
16 : Plantago media, Plantain moyen, Plantaginacée.
Petite plante à racine pivotante et multiples radicelles. Feuilles basales en rosette, ovales-elliptiques, entières, à nervation marquée. Inflorescences en épis portant des fleurs hermaphrodites dont les pistils arrivent à maturité avant les étamines à anthères blanches et filets roses.
N.B. : Les feuilles fraiches écrasées sont utilisées en massage doux sur les piqures de moustique, guêpe, abeille, frelon ou d’ortie.
17 : Rameau de Prunus mahaleb, Cerisier de Sainte Lucie, Rosacée.
Il fleurit après Prunus spinosa, on reconnait ses feuilles qui sont refermées comme un livre entrouvert.
Beaucoup à dire dessus : Wikipédia.
18 : Prunus spinosa, buisson et fleur, Prunellier. Rosacée.
En fin de floraison. Fleursauvageyonne. Ses nombreuses fleurs blanches ont disparu.
On peut faire une liqueur à partir de ses cerises
19 : Prunus mahaleb, Cerisier de Sainte-Lucie, Bois de Sainte-Lucie, Rosacée.
Le terme mahaleb vient du latin scientifique de la Renaissance almahaleb, par emprunt à l’arabe mahlab, محلب, désignant le même cerisier sauvage.
Le nom de « Bois de Sainte-Lucie » trouve son origine d’un couvent de Minimes, Sainte-Lucie-du-Mont, situé sur les hauteurs de Sampigny (Meuse) où s’est développé au XVIIe siècle un artisanat d’objets religieux fabriqués dans le bois de cette essence que l’on trouve abondamment aux alentours du couvent.
À la base du limbe ou sur le pétiole, des nectaires sécrètent un liquide sucré qui attire les fourmis, lesquelles protègent en retour le cerisier des insectes susceptibles de ronger les feuilles. Le parfum qui se dégage du bois, de l’écorce et des feuilles provient de la coumarine que contiennent aussi certaines graminées et qui contribue à donner au foin fraîchement fauché son odeur caractéristique.
20 : Inflorescence de Sesleria caerulea, la Seslerie bleue, Poacée poussant en touffes parfois épaisses, cette Poacée stabilise les pentes des sols secs, rocailleux et les pelouses sèches sur sols calcaires de la roche de Solutré. Cette graminée y est très courante, elle est facilement reconnaissable à son épi floral assez court lavé de bleu foncé, aux reflets métalliques vers le sud (réaction contre les U.V.) et vert de l’autre.
N.B. : Attention, ses feuilles fines et coriaces peuvent être coupantes.
21 : Viscum album, gui, fleur de pied mâle, Santalacée.
Hémiparasite, il développe un haustorium (suçoir) lui permettant de se fixer sur une branche et de prélever des nutriments, mais étant chlorophylien, il réalise sa propre photosynthèse.
N.B. : Sa graine est arrivée après avoir traversé le tube digestif d’un oiseau (grive, merle, .. )
Voir : Observation du 10 février 2023 : Le gui, une plante étonnante !