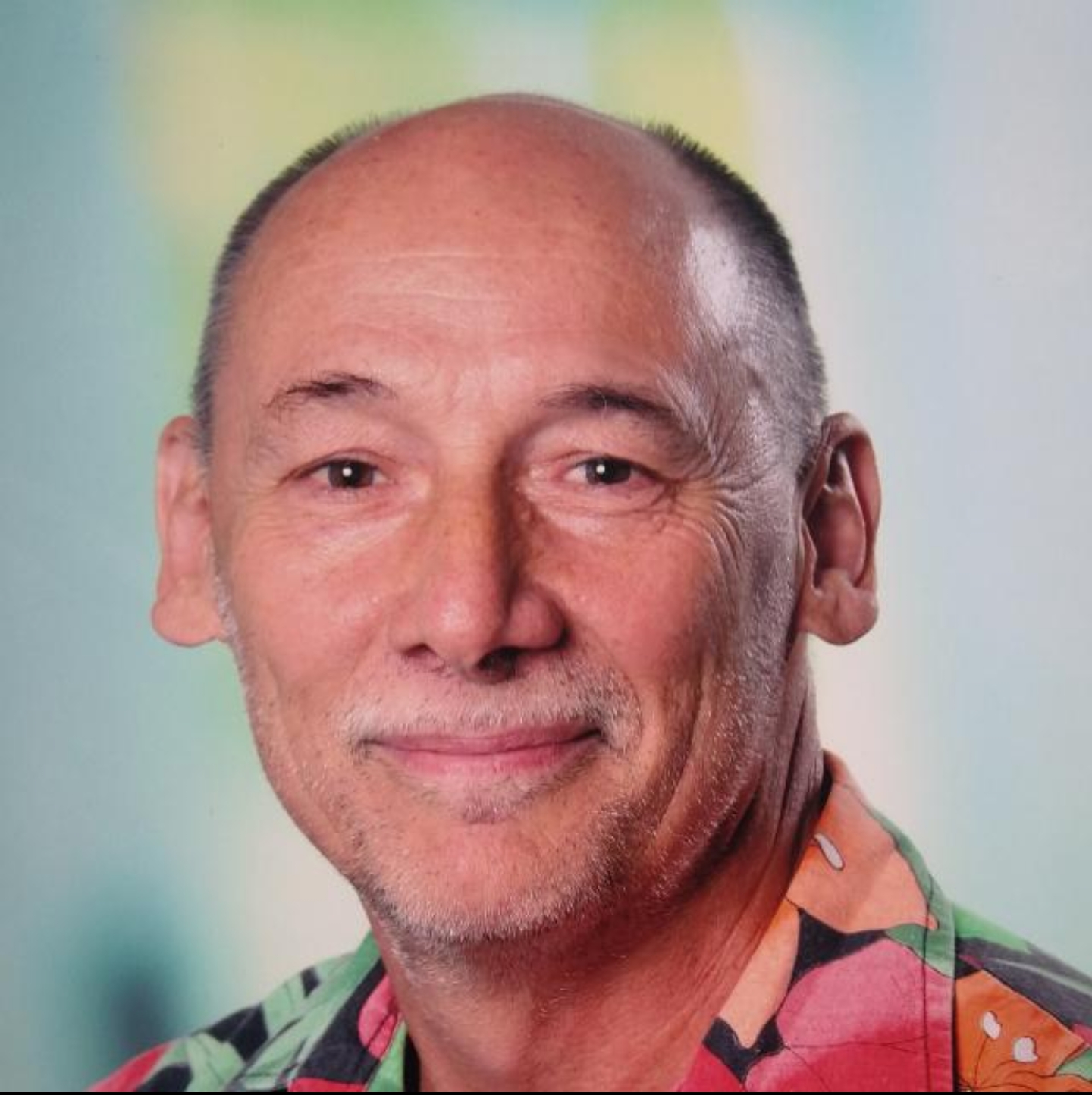Sortie sur la teppe et le bois de Fée….
Rendez-vous au lieu dit « les combettes » pour une inspection de la végétation au dessus de Leynes en vue d’une prochaine sortie à vous proposer.
Le mont de Leynes et le bois de Fée sont situés aux confins du Mâconnais, sur des calcaires décalcifiés de pente et de plateau. Photo d’accroche par Bourgogne-Tourisme.
La table d’orientation, implantée à 417 mètres d’altitude au dessus de Leynes, offre un magnifique panorama sur le Beaujolais, la vallée de la Saône, le Revermont et les Alpes.
Après avoir goûté au plein soleil des pelouses calcaires, nous avons longé le bois sans trouver la moindre feuille d’orchidée, puis nous sommes revenus par le chemin du sous-bois.
N.B. : Dans la forêt, courrant sous et sur les feuilles de la litière au moindre dérangement, nous avons observé des centaines de petites araignées du genre Pardosa (plus de 500 espèces -40 en Europe- que l’on trouve dans toutes les régions du monde). On les reconnaît à leurs bandes claires, médianes et latérales et leurs pattes, relativement longues, munies d’épines perpendiculaires, surtout visibles sur les pattes postérieures. Elles ne tissent pas de toile mais chassent leurs proies à courre et bondissent dessus. Ce comportement leur a valu le surnom d’araignées-loups.
Liens : Jessica Joachim et Un monde dans mon jardin.
Liste des plantes vues dans les pelouses : (Ordre alphabétique)
N.B. : Une callunaie jouxte la pelouse semi-aride à Brome.
Anacamptis morio, L’orchis bouffon, Orchidée.
Tient son nom de l’espagnol Morion qui désignait le casque des fantassins de la Renaissance, ses sépales formant un casque bien régulier. Il est peu commun mais se rencontre généralement en larges groupes, de préférence dans les pelouses ensoleillées à tendance acide. (FloreAlpes).
Caractérisé par ses sépales et ses pétales ornés de fortes « nervures »griffures » vertes :

Anthoxantum odoratum, la Flouve odorante, une Poacée.
Son nom de genre provient du grec anthos (« fleur ») et xanthos (« jaune »), par allusion à ses fleurs jaunes après la floraison. Ses noms d’espèce « odoratum » et « odorante » font référence à son odeur de coumarine après dessiccation.

3 Carex, Cyperacées :
Carex vient de (cairô), couper de près en grec ancien, car ils ont souvent des feuilles coupantes.
Carex caryophyllea, la Laîche printanière :
Utricules finement pubérulents, à bec très court, à trois styles. FloreAlpes.
N.B. : Le mot « laiche » vient du préroman liska, plante des marais si utile pour nos ancêtres qui fauchaient et séchaient les laiches pour en faire de la litière.

Carex flacca, la Laîche glauque :
La plupart des tiges ont deux épis mâles à leur sommet, souvent proches et semblant ne faire qu’une au premier coup d’œil. Les épis femelles sont généralement situés en dessous, aussi par deux, et peuvent être à pétiole court et droit, ou à plus long pétiole et courbés. (Wikipédia)
Tient son nom vernaculaire de la couleur glauque de son feuillage et de sa tige.
Ses épis mâles peuvent être au nombre de trois, ses épis femelles peuvent être au maximum 5. Sa tige est de section triangulaire. Les épis femelles à maturité pendent sur le côté de la tige. (FloreAlpes)

Carex halleriana, Laîche de Haller :
Dédiée au médecin-botaniste-poète-magistrat suisse Albrecht von Haller (1708-1777).
Fréquent dans les pelouses sèches et les sous-bois. Il se reconnaît facilement à ses épis naissant les uns au sommet de la tige, les autres à la base de cette dernière. Les épis de la base sont des fleurs femelles, portées par de fins pédoncules. Les feuilles sont étroites et raides, plus longues que la tige. (FloreAlpes).
Calluna vulgaris, la Callune, Ericacée.
Commune, elle se distingue du genre Erica par ses feuilles opposées en forme de petites écailles sessiles imbriquées sur 4 rangs (les feuilles sont en aiguille et disposées par 3 chez Erica, la véritable bruyère). (Wikipédia).
Juniperus communis (mâle et femelle), le genevrier commun qui produit les baies de genièvre (femelle)
Luzula campestris, la Luzule champêtre (belle photo Wikipédia) et Naturescene.

Neotinea ustulata, Orchis brûlé. Orchidée.
Dès que les fleurs sont fécondées, l’épi floral s’allonge et l’extérieur des fleurs devient plus clair. C’est donc le sommet de l’épi qui présente cette couleur de brûlé caractéristique.

Dans les coins ombragés et les haies : Prunus spinosa
Scorzonera humilis, la Scorsonère des prés, Petite scorsonère ou Scorzonère humble, Astéracée.
Nom de genre : de l’italien scorzo, racine, et nera, noire, par allusion à sa souche noire et volumineuse.
Nom d’espèce : humilis qualifie les plantes qui sont peu élevées et qui restent près du sol (qui se dit humus en latin).

Viola alba et Viola hirta.
Liste des plantes vues sur les bords du chemin dans le sous bois : (Ordre alphabétique)
Alliaria officinalis,
Anemone nemorosa,
Aquilegia vulgaris,
Asplenium trichomanes,
Cedrus atlantica et Pinus nigra (plantations humaines)
Wikipédia : Les feuilles de P. nigra, nommées aiguilles, sont groupées par deux dans une gaine ; elles sont de couleur vert-jaune (sous-espèce salzmannii) à vert foncé (sous-espèce nigra) et font de 8 à 20cm.
Ficaria verna,
Helleborus foetidus,
Hieracium maculatum ou glaucinum, l’Épervière tachée, Asteracée.
FloreAlpes : Feuilles basales plus ou moins glauques, maculées ou pas, plus ou moins dentées à la base, à marge comportant des poils inégaux. Inflorescence en corymbe peu fourni. Espèce des pelouses et bois chauds et secs. Plante précoce pour une épervière, ce qui aide à son identification.
Lamium purpureum et maculatum :

Lathyrus linifolius, la Gesse des montagnes :

Pinus nigra, le Pin noir, Pinacée. (Plantation humaine)
Wikipédia : Les feuilles de P. nigra, nommées aiguilles, sont groupées par deux dans une gaine ; elles sont de couleur vert-jaune (sous-espèce salzmannii) à vert foncé (sous-espèce nigra) et font de 8 à 20cm.
Potentilla sterilis,
Primula veris,
Pulmonaria montana, La Pulmonaire des montagnes, Boraginacée.
Voir le monde de LUPA et mon article sur les pulmonaires

Nous y reviendrons cet été pour observer :
– Le Genêt d’Allemagne (Genista germanica), arbrisseau rarissime en Bourgogne et typique des milieux peu acides,
– la Coronille faux-sené (Hippocrepis emerus), arbuste méridional protégé réglementairement proche de la limite nord ouest de son aire de répartition,
– le Silène d’Italie (Silene italica), plante méditerranéenne rarissime en Bourgogne, en limite nord de son aire de répartition et dont la quasi-totalité des stations régionales se trouve dans le Mâconnais.
Voici les photos prises ce jour, saurez vous les reconnaître? Prenez un papier, réponses en desous …



















1 Carex halleriana (Laîche de Haller), Cyperacée. Lien
2 Pulmonaria montana (Pulmonaire des montagnes), Boraginacée. Tige arrondie. Feuilles d’été souvent nécessaires à la détermination. Comparaison avec P. obscura.
3 Stellaria holostea (Stellaire holostée). Caryophyllacée. Lien
4 Primula veris (Primevère officinale ou coucou). Primulacée. Lien.
5 Lamium maculatum (Lamier à feuilles maculées). Lamiacée. Bien plus grand que le lamier pourpre ( vu lui aussi). Ses feuilles sont souvent panachées de blanc en hiver. INPN.
6 Alliaria officinalis (Alliaire officinale). Brassicacée. Feuilles cordiformes, dentées et luisantes dégageant une odeur d’ail quand elles sont froissées.
7 Helleborus foetidus (Hellebore fétide). Renonculacée toxique. Feuilles persistantes palmatiséquées ; fleurs en cloche penchée (protection contre les intempéries) à 5 sépales jaune-verdâtre à bords rougeâtres; follicules à bec crochu ; odeur désagréable. Sur sols calcaires. Les 5 pétales produisent un nectar, ainsi qu’une levure qui, en fermentant, assure un chauffage d’appoint ! Lien.
N.B. : Fleurit ordinairement deux fois, la première fois vers cinq ans (entre quatre et neuf ans, parfois déjà la seconde année). De nouvelles tiges naissant de la souche assurent une seconde floraison l’année suivante, cette seconde floraison étant généralement suivie par la mort de la plante.
8 Juniperus communis femelle, (Genévrier commun) Cupressacée. Se distingue du genévrier cade (Juniperus oxycedrus) par ses aiguilles n’ayant qu’une seule large bande blanche (alors que les aiguilles du cade ont deux bandes parallèles plus étroites), et par des fruits plus petits et plus sombres.
Les pieds femelles produisent les « baies de genièvre ». Cet arbuste a besoin de beaucoup de lumière. Ses aiguilles sont rayées d’une unique bande blanche. Les baies prennent deux (trois) ans pour mûrir, initialement elles sont d’abord vertes, puis pruineuses et à maturité elles ont une couleur bleu-violet.
En cuisine, les baies de genévrier, avec leur arôme chaud et résineux, sont utilisées pour aromatiser les gibiers, le porchetta, les jambons, les ragoûts, les poissons, le pâté, les saucisses, les garnitures, etc., et se combinent bien avec des légumes marinés et les choux (choucroutes). LIEN.
9 Pinus nigra (Pin noir d’Autriche). Pinacée. La couleur de son écorce est jaune-brun à gris selon les sous-espèces ; elle est couverte de larges écailles plates séparées par de profondes fissures qui s’élargissent de plus en plus avec l’âge. Aiguilles sombres groupées par deux et très longues (> 8 cm)
Deux autres sous-espèces peuvent êtres observées dans les Hautes-Alpes : le Pin Laricio et le Pin de Salzmann. Les aiguilles sont de couleur vert-jaune chez la sous-espèce salzmannii.
10 Potentilla sterilis (Potentille stérile). Rosacée. Sterilis : car elle ne forme pas de fraise. Son port rappelle celui du fraisier des bois (Fragaria vesca). Sa fleur comporte 5 pétales en coeur espacés laissant voir les sépales. Voir Jessica. Le dessous des feuiles est velu comme son pétiole et la dent terminale de chaque folliole est plus courtte que ses 2 voisines, (contrairement aux fraisiers) : Photo INPN.

11 Juniperus communis mâle Cupressacée.

12 Aquilegia vulgaris (Ancolie commune) Cupressacée.
Ses fleurs sont composées de sépales pétaloïdes et de pétales en forme de cornet avec un éperon recourbé à l’arrière. Comparaiason FloreAlpes avec A. alpina
13 Anemone nemorosa, (Anémone des bois). Renonculacée.
14 Viola hirta (Violette hérissée). Violacée. Ni odeur, ni tige ni stolon. Hérissée de poils courts. Feuilles crénelées, cordiformes, en rosette, velues surtout dessous et à leur base. Sépales émoussés et une couleur violet bleu plus pâle différencient cette violette des autres. Pousse dans les broussailles ouvertes.
15 Cedrus atlantica (Cèdre de l’Atlas) Se distingue des autres cèdres par ses rameaux dressés à aiguilles bleutées, courtes (2 à 2,5 cm). Certaines branches portent des cônes mâles, d’autres des cônes femelles.
16 Asplenium trichomanes (Capillaire des murailles) Aspleniacée. Le rachis de ses frondes est fin, brun rougeâtre et luisant. Pennes insérées obliquement sur le rachis terminé par une petite penne.
17 Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille des bois) Caprifoliacée. Cette feuille appartient à une liane arbustive montant jusqu’à 4 mètres en s’enroulant autour des tiges dans le sens lévogyre. En étranglant leur support, elles peuvent causer des dégâts aux jeunes arbres. Les fleurs sont très parfumées.
N.B. : Sur la photo, la feuille est minée par la larve d’une mouche.
Voir la faune entomologique des chèvrefeuilles.
18 Viola alba (Violette blanche). Violacée. A stolons non radicants et florifères. Feuilles : vert-jaunâtre, toutes en rosette basilaire, cordées, crénelées, pubescentes, à long pétiole velu. Ne doit pas être confondue avec les formes à fleurs blanches notamment de Viola odorata (Viola odorata f. albiflora) dont les stolons sont radicants. societedhistoirenaturelledujura. LIEN photo.
19 Prunus spinosa (Prunellier). Rosacée. Forme des buissons inextricables (nombreuses épines acérées). Ses nombreuses fleurs blanches apparaissent début mars, dégageant une odeur de miel. La floraison précède la feuillaison. Comparaison des fleurs avec Prunus mahaleb (arbustif à arborescent) :

La floraison de P. mahaleb commence quand celle de P. spinosa est presque terminée.
Chez P. mahaleb, floraison et feuillaison sont concomitantes et leurs feuilles sont bien différentes.
Voir prochain aricle sur les Prunus dans le Référentiel.